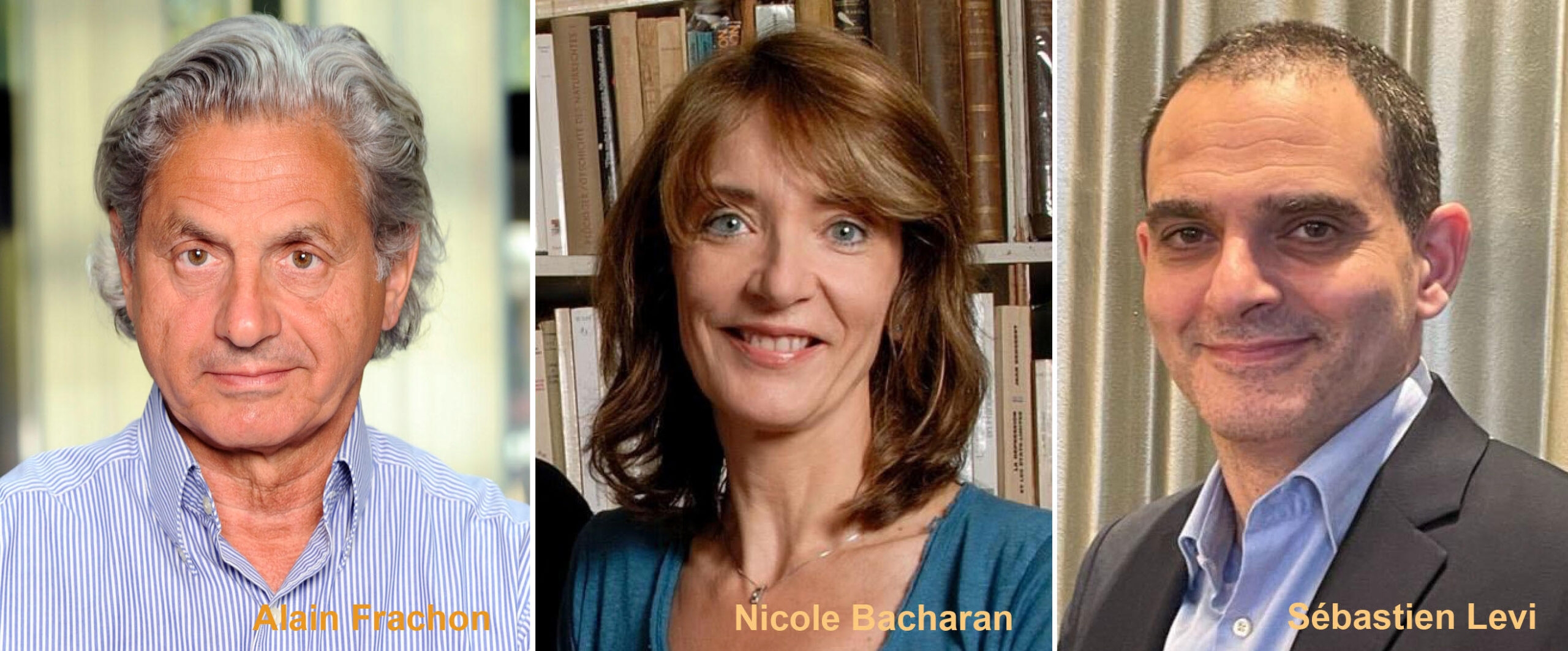L’auteur de ce livre est né et a grandi dans le mellah de Meknès. En 1962, âgé de quinze ans, il partit pour Israël. Son intégration dans l’État juif commença par trois années dans une école agricole. Autant que le travail de la terre, on y enseignait l’appartenance à la nation hébraïque. «Il n’était pas question de parler en langues étrangères. Surtout pas en arabe que l’on devait bannir, alors que c’était la langue maternelle de plusieurs d’entre nous. (…) Même les prénoms à connotation arabe devaient être changés. Le mien, par exemple, Makhlouf, fut replacé par Mickaël, sans me demander mon accord.»
Avec plusieurs décennies de recul, Mickaël Parienté sait remettre ce traitement dans son contexte. Les responsables de l’école agricole, écrit-il, voulaient faire «de tous les autres jeunes venus du Maroc, de Tunisie, de Roumanie, de Pologne, de Russie, d’Iran ou d’ailleurs, des Juifs d’un genre nouveau, des Israéliens dépouillés de leurs traditions, de leurs langues, de leurs rites». Et pour cela il fallait les dépouiller, non pas de la culture de tel ou tel pays diasporique, mais de la culture de l’Exil. Ce fut un rude apprentissage, dont l’auteur éprouve encore la marque. «Mon identité a été rebâtie comme s’il s’agissait d’une seconde naissance », constate-t-il. Et il énonce une interrogation à laquelle il n’est pas de réponse simple : «Identité brisée ou identité recomposée?»
Mickaël Parienté a vécu en Israël un quart de siècle, puis il est parti pour Paris en 1988, y a ouvert une galerie, et a œuvré pour faire connaître la culture israélienne. En témoigne le préfacier du présent ouvrage, Yehuda Lancry, qui fut ambassadeur d’Israël en France avant de représenter son pays aux Nations Unies. Invoquant la définition de Hassan II, roi du Maroc, selon laquelle «tout Marocain expatrié» est «un ambassadeur permanent du Maroc dans son pays d’accueil», Yehuda Lancry écrit que Parienté a exercé son activité à Paris comme «un ambassadeur de l’image, du renom et du prestige d’Israël».
Cet Israélien expatrié et resté fidèle à son pays s’affirme, dans le livre qu’il vient de publier, «ardemment attaché à la conviction qu’Israël doit être un État juif». Mais, ajoute-t-il aussitôt, cela ne peut se justifier «que si l’écrasante majorité de la population est constituée de Juifs» – en d’autres termes, si Israël «se détache des territoires occupés». Et il insiste: «Une séparation s’impose de manière urgente, que ce soit après un accord ou sur une décision unilatérale.» Alors, la majorité juive de la population veillera au respect des principes énoncés dans la Déclaration d’Indépendance de l’État: « justice et paix, liberté de conscience, de culte, d’éducation et de culture, une citoyenneté égale et complète pour tous sans distinction de croyance, de race et de sexe».
Le principal obstacle à une telle évolution est le pouvoir exercé par Benyamin Netanyahou, l’homme «qui a semé la division et la haine» au sein du peuple israélien. «Il concentre toute son énergie à sa survie politique, accuse pêle-mêle, la police, le procureur général, le conseiller juridique du gouvernement, la presse et tous ceux qui ne sont pas de son camp. Pour justifier son attitude, il mobilise ses électeurs en les convainquant qu’il est victime d’une tentative de coup d’État ourdie par les institutions. Il les appelle à la rébellion et s’adresse surtout aux citoyens de la périphérie qui, pour des raisons historiques, se méfient de ces institutions». Et ici, nous revenons à la césure ashkénaze/sépharade.
Mickaël Parienté souligne, à juste titre, que «les fondateurs de l’État d’Israël» n’avaient «aucune intention ségrégationniste»: ils «ont fait de leur mieux pour rassembler les Juifs de la Diaspora» autour d’«une seule culture, harmonieuse et commune». Mais le problème est qu’ils voulaient aussi «que cette nouvelle culture israélienne soit occidentale, et plus précisément européenne». D’où leur effort pour «effacer les cultures et les traditions issues de pays arabes», un effort qui «engendra dans la communauté sépharade un choc culturel permanent».
On pourrait lui objecter qu’avant la création de l’État, le mouvement sioniste en Palestine britannique avait interdit avec la même férocité la langue maternelle de la plupart des immigrants juifs. En effet, parler uniquement l’hébreu (en hébreu dans le texte: rak ivrit) était un mot d’ordre visant non pas l’anglais du pouvoir mandataire, et encore moins l’arabe, mais le yiddish. Cette objection, cependant, n’est pas recevable. Car l’interdiction du yiddish, dans le yishouv (la communauté juive d’Eretz Israël), était prononcée par des dirigeants sionistes dont le yiddish était généralement la langue maternelle, et qui héritaient du combat pour la primauté de l’hébreu lancé à la fin du dix-neuvième siècle par Eliezer Ben-Yehouda. En revanche, ce que dans les années 1960 des jeunes immigrants ont perçu comme une interdiction de la langue arabe était le fait d’un encadrement dont on peut supposer qu’il était majoritairement ashkénaze – et cela se passait dans un État juif dont les dirigeants étaient presque tous ashkénazes. La première interdiction, pour brutale qu’elle fût, était vécue comme un conflit interne à la communauté ashkénaze d’origine ; la seconde interdiction fut vécue, à tort ou à raison, comme un conflit inter-communautaire ashkénaze-sépharade dont les implications humaines et sociales nous paraissent aujourd’hui évidentes.
Parienté a donc raison de déplorer, chez les responsables israéliens de l’intégration des immigrants issus du monde arabe, une «absence de vision» qui «a créé un traumatisme psychologique et entraîné des frustrations, des règlements de comptes, des désirs de réhabilitation d’une identité perdue». L’auteur dit sa conviction qu’aujourd’hui «il est temps de tourner la page, de cicatriser la rupture entre le “Second Israël” et le reste de la population juive». Il dit aussi son espoir «que les générations futures, dont une grande partie est issue de familles mixtes, dépassent ces clivages, se sentant israéliens avant tout».
Si la question de l’identité est douloureuse, c’est qu’elle ne se pose pas seulement au niveau de l’individu ou de la communauté d’origine. Elle se pose au niveau du pays tout entier: tiraillés entre des identités partielles et contradictoires, les Juifs israéliens peinent encore à définir une identité globale qui les réunisse vraiment et qui s’élargisse harmonieusement à leurs concitoyens arabes. Dans le titre du livre de Mickaël Parienté, la «dérive morale» précède l’«impasse politique», comme si la seconde n’était que la conséquence de la première. Mais peut-être existe-t-il un rapport dialectique entre la cause et l’effet, peut-être faut-il sortir Israël de l’impasse politique où il se trouve afin de mettre un terme à la dérive morale dont il est victime.
Meïr Waintrater
Mickaël Parienté, Israël: Dérive morale – Impasse politique, Éditions StavNet, Paris.