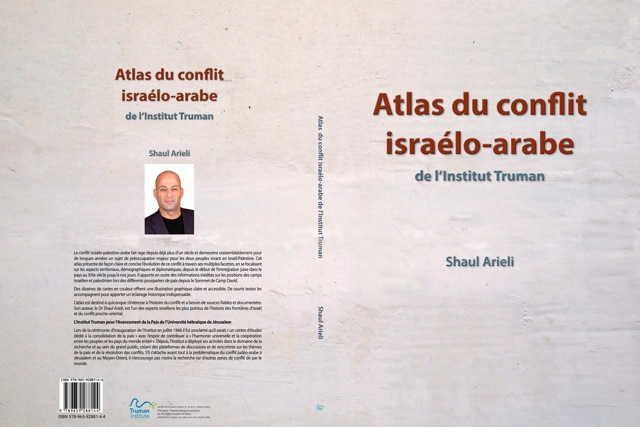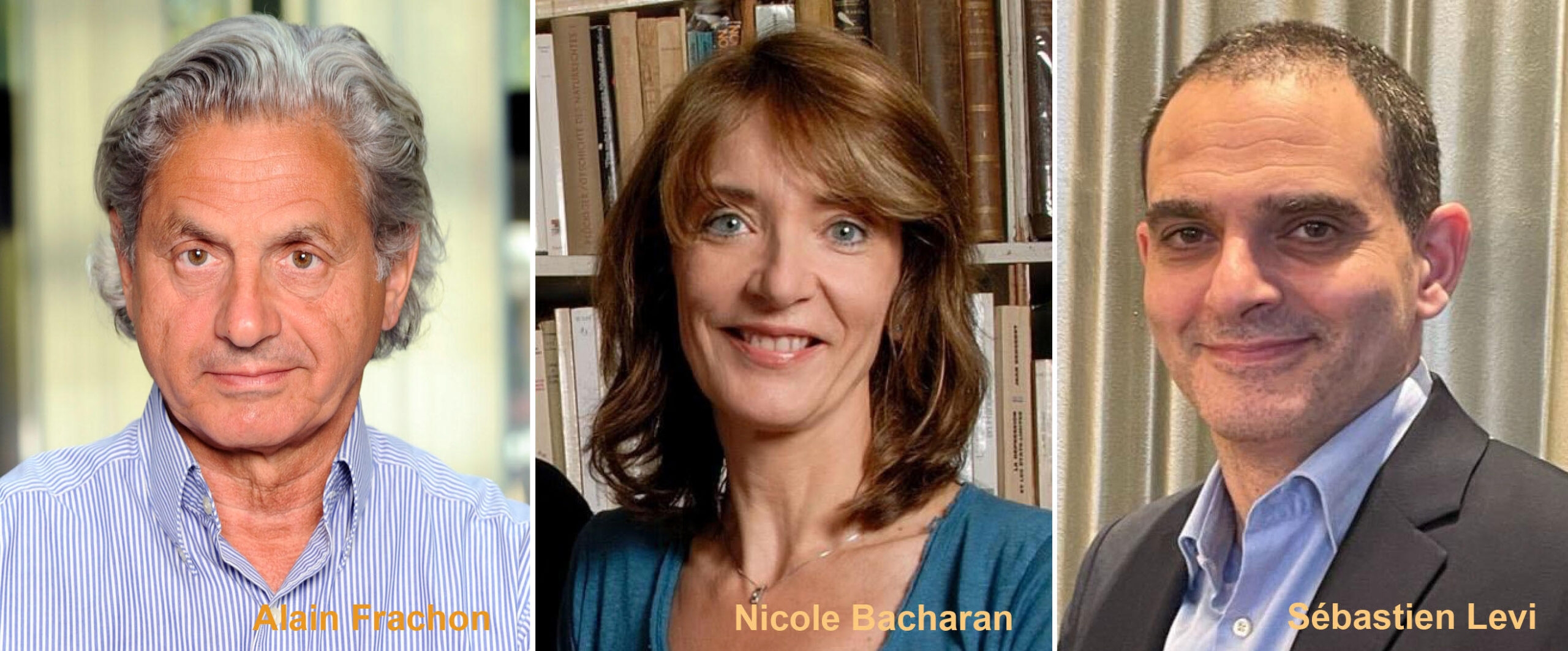Manifestations devant le département de l’éducation contre les coupes budgétaires à Washington le 13 mars 2025 – Près de 100 000 d’Israéliens en marche vers Jérusalem pour manifester contre le gouvernement le19 mars 2025
Israël et les États-Unis sont aujourd’hui dirigés par deux hommes unis par une même paranoïa, un rejet des normes démocratiques ou encore une absence totale de moralité.
Dans ces deux pays, les institutions démocratiques sont aujourd’hui ébranlées par des attaques incessantes contre la presse, la justice, la neutralisation des garde-fous institutionnels, risquant de changer profondément la nature de leurs régimes.
Devant ces attaques similaires sur bien des plans, la réaction citoyenne est, elle, totalement différente dans les deux pays.
Alors que la rue israélienne s’est mobilisée une première fois en 2023 puis de nouveau depuis quelques semaines, avec une intensification depuis le renvoi du chef du Shin Beth, la destruction systématique des institutions par Trump ne crée que des réactions éparses et surtout assez faibles.
Le paradoxe, qui n’est qu’apparent, est que la vigueur de l’opposition est beaucoup plus forte en Israël, le plus jeune pays des deux, avec les institutions les moins éprouvées.
Dans ce pays, les citoyens ont conscience de la fragilité non seulement de leur existence nationale et physique, mais aussi celle de leurs institutions, en l’absence d’une constitution écrite et avec seulement deux branches du gouvernement, le gouvernement étant l’émanation directe du Parlement et non trois comme aux USA, avec un Congrès indépendant (en théorie…) de l’exécutif.
Il existe dans la psyché israélienne un sentiment de vulnérabilité, qui tient tant à l’histoire du peuple juif qu’a la géographie de l’État d’Israël. Le fait d’avoir des institutions peu éprouvées explique aussi la compréhension fondamentale par les Israéliens qu’ils sont la seule ligne de défense, sans pouvoir compter sur personne ou quoi que ce soit d’autre, et ce qui est valable pour leur sécurité concerne aussi la nature démocratique de leur pays.
Ce sentiment de vulnérabilité est aujourd’hui absent chez les Américains, à l’abri de guerres sur leur sol depuis la guerre de Sécession (le 11 septembre est un acte terroriste, pas une guerre), et qui pensent par ailleurs que leurs institutions sont assez solides pour les protéger.
Il existe en effet aux États-Unis une révérence envers la Constitution et les pères fondateurs, (dont la simple appellation est révélatrice de leur statut), qui sont célébrés comme des quasi-divinités, inventeurs des « checks and balances » qui préserveraient la démocratie américaine contre toute attaque, fut elle d’un président aux tendances autocratiques.
Il est peu probable cependant que ces pères fondateurs aient prévu un président Trump à l’âge des réseaux sociaux et de la post-vérité, et la démocratie américaine vit aujourd’hui son épreuve de vérité.
Le Congrès étant aujourd’hui neutralisé aux États-Unis, par la soumission des Républicains et le refus des Démocrates de démarrer une véritable épreuve de force, il ne reste aujourd’hui que la Justice et la presse pour s’opposer à Trump, et il n’est guère étonnant que ce dernier les attaque de manière particulièrement agressive.
La presse dans son ensemble joue encore son rôle mais son affaiblissement au profit des réseaux sociaux laisse la Justice en première ligne pour défendre la démocratie américaine, en particulier après les purges opérées par Trump au sein du FBI, de l’armée ou d’autres institutions fédérales.
Le paradoxe est que Trump a tellement parlé du « Deep State » (L’État profond) que ses partisans ne sont peut-etre pas les seuls à y croire. Ses opposants semblent penser qu’une force supérieure viendra les sauver, même après les purges opérées, et que cette force pourrait être celle des institutions et surtout des juges que Trump qualifie de « corrompus » tous les jours, dans des attaques tellement outrancières qu’elles ont conduit John Roberts, le chef (conservateur) de la Cour Suprême à sortir de sa réserve pour les défendre.
Autre « amortisseur » pour les Américains : la nature fédérale du pays, qui leur permet de vivre leur vie à l’abri des soubresauts des changements politiques nationaux. Cette impression de (fausse) sécurité concerne non seulement la vie quotidienne, mais aussi la croyance que les institutions de leur propre État, et au premier rang desquels leur gouverneur, les protègera de toute mesure extrême décidée et appliquée par Washington.
La nature du pays et sa taille mettent Israël à l’abri d’une telle complaisance et d’un faux sentiment de sécurité. Si on parle parfois de bulle à tel Aviv, il suffit de parcourir 7 kilomètres pour être à Bnei Brak, ville ultra-orthodoxe, et la distance entre Jérusalem et Tel Aviv n’est que de 60 kilomètres… Il n’existe ainsi pas d’autorité indépendante ou autonome du pouvoir central en Israël, et la politique du gouvernement a un impact direct et souvent immédiat sur la vie de tous les Israéliens.
En d’autres termes, les Israéliens savent qu’ils ne peuvent rester passifs lorsque l’essentiel est en jeu. Cela s’est traduit par l’afflux d’Israéliens du monde entier vers leur pays à la suite du 7 octobre pour prendre les armes et défendre leur pays, mais aussi la mobilisation citoyenne massive pour défendre la démocratie.
Le patriotisme des Américains n’est pas remis en question ici, mais plutôt un sentiment de complaisance (‘Complacency ») qui pourrait bien être le meilleur allié de Donald Trump dans sa marche folle pour changer profondément son pays et le rendre méconnaissable, aux yeux du monde et surtout auprès des Américains eux-mêmes. Il est à espérer que ces derniers sauront réagir à temps pour éviter le pire, et prendre exemple sur Israël, pays dont la vulnérabilité physique et institutionnelle a renforcé la vigilance sécuritaire et les anticorps démocratiques.
Sébastien Lévi